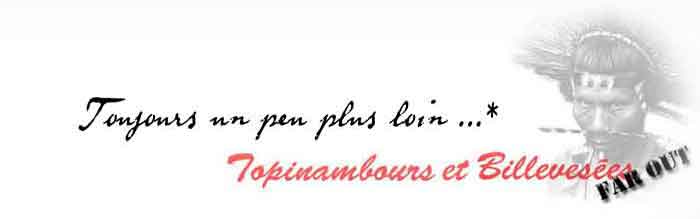Le magnétisme animal, et plus encore le somnambulisme magnétique, n'ont encore été que peu étudiés par les historiens.
Les origines du romantisme et de l'hypnose donnèrent lieu aux premiers travaux qui conduisirent à plusieurs publications à la fin des années 1960.
Le psychiatre Henri Frédéric Ellenberger appartient ainsi aux pionniers de l'exploration de ces domaines puisqu'il fut un des premiers à mettre au jour la multiplicité des pratiques et des phénomènes magnétiques en Europe.
Son livre The Discovery of the Unconscious. The History and Evolution of Dynamic Psychiatry, publié pour la première fois en 1970, réédité et traduit depuis dans de multiples langues, demeure toujours une référence essentielle par sa richesse factuelle et son érudition.
Sur l'ampleur des effets politiques et idéologiques du magnétisme animal à la fin du XVIIIe siècle, le livre de l'historien Robert Darnton, Mesmerism and the End of the Enlighment in France publié en 1968, fut lui aussi novateur et reste encore unique par son questionnement politique.
Robert Darnton y relie étroitement la fin des Lumières à l'émergence de courants spiritualistes issus du mesmérisme au début du XIXe siècle.
Il estime que le mesmérisme participe ainsi à la résolution de la question à laquelle sont confrontés bien des penseurs des Lumières après la Révolution française et la période de la Terreur.
Prenant pour exemples le physiocrate Dupont de Nemours d'une part et Condorcet de l'autre, il oppose les deux solutions que ces hommes font alors émerger, le recours à un spiritualisme, à l'élaboration d'une théodicée naturelle pour le premier et à la croyance au Progrès qui triomphera de la superstition pour le second.
Et Robert Darnton conclut :
"Après la Terreur, les mesméristes peuvent être révolutionnaires comme Bonneville ou conservateurs comme Bergasse, mais ils ne bâtiront pas leurs temples sur les fondations de la raison."
Ces phénomènes longtemps oubliés, dans leur temps d'émergence, furent souvent occultés en tant que savoirs (et même condamnés en France) ou moqués en tant que croyances, peut-être parce qu'ils ouvraient sur une vision et une connaissance de l'homme et du monde difficiles, voire impossibles, à penser dans ces décennies post-révolutionnaires de remise en ordre sociale et politique.
Le magnétisme animal a irrigués les savoirs médicaux qui ont transformé très lentement, et de manière non linéaire, l'observation et les soins de ce que nous appelons aujourd'hui les maladies nerveuses et mentales.
Le médecin Franz Anton Mesmer est directement à l'origine de ces phénomènes puisqu'il est le découvreur du magnétisme animal.
Dans les dernières décennies du XVIIIe siècle, ce médecin autrichien, a élaboré une théorie globale de la santé et de la maladie; l'ensemble de cette théorie et sa mise en pratique furent souvent nommés mesmérisme.
Mesmer, le magnétisme animal et le somnambulisme magnétique ont ainsi laissé des marques profondes dans l'histoire sociale et culturelle des sciences médicales : leurs héritages se sont en effet largement diversifiés selon les lieux et les moments.
Christine Bergé découvre le versant religieux, voire mystique, du somnambulisme magnétique lorsqu'à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, des francs-maçons se passionnent pour le magnétisme animal.
Elle propose ici une étude des nombreux cahiers manuscrits de la sœur de l'un d'entre eux, la chanoinesse Marie-Louise de Monspey (1733-1813) dite l'Agent inconnu.
Ces écrits se veulent porteurs d'une interprétation ésotérique de l'anatomie humaine et sont étudiés avec grande attention par des frères maçons des plus hauts grades.
Les liens entre corps et âme, entre matière et esprit constituent l'un des questionnements récurrents révélés par le magnétisme aninal et ce dernier trouve ainsi dans l'Allemagne romantique du début du XIXe siècle, dans la génération des Naturphilosophen, un terrain propice à son développement et il est à nouveau question de la découverte de l'inconscient sous la forme d'une conscience de l'involontaire.
Il est à nouveau question également de la place des femmes, si particulière dans leurs liens avec le somnambulisme magnétique.
Les somnambules sont en effet majoritairement des femmes, soit guérisseuses voyant les maux à l'intérieur des corps, soit patientes soignées par magnétisme.
Les sources connues le montrent abondamment.
Deux articles présentent plus en détail les maladies de deux femmes aux soins desquelles deux médecins ont participé de près ou de loin : Alexandre Bertrand (1795-1831), polytechnicien, médecin hospitalier à Paris et Antoine Despine (1777-1852), médecin-directeur des eaux d'Aix-les-Bains.
Jacqueline Carroy, en analysant la correspondance encore inédite d'une riche cliente suisse, Joséphine Lüdert, avec Antoine Despine nous permet de comprendre comment des médecins du début du XIXe siècle ont pu pratiquer et interpréter le magnétisme animal.
C'est aussi à travers les notes et lettres de ce même médecin et de son confrère parisien Alexandre Bertrand que Jan Goldstein étudie la maladie de Nanette Leroux, patiente pauvre cette fois, puisqu'il s'agit d'une jeune campagnarde savoyarde soignée aux eaux d'Aix par charité.
Cette étude de la naissance du magnétisme animal à la fin du XVIIIe siècle et de son déploiement dans les premières décennies du XIXe siècle, montre comment, autour des balbutiements de ces nouveaux savoirs médicaux, se constitue une culture appuyée sur des réseaux de sociabilité alliant médecins, patients, croyants ou curieux, et soutenue par des échanges constants et syncrétiques entre pratiques thérapeutiques, croyances et théorisations.
On passe ainsi de l'électrisation aux bains, à la magnétisation ou à l'automagnétisation ; on s'échange les somnambules lucides, on lit les livres de Swedenborg, de Fourier, de Saint-Simon, on fait des expériences fluidiques, on théorise…
Nicole Edelman, "Introduction, Revue d'histoire du XIXe siècle"